-
Articles récents
G.F.I.V. éditions
Quelques endroits où je passe souvent
- Grégoire Courtois
- Branloire pérenne
- Zoë Lucider
- Dans l'herbe tendre
- Blog de Paul Edel
- Minuit dans le jardin
- SYNCOPES
- L'Ex, homme-âne-yack
- Le Promeneur
- Le photographe minimaliste
- LE LIVRE SANS VISAGE
- ETC-ISTE
- Ruines circulaires
- Journal documentaire
- nos consolations
- le vieux monde qui n'en finit pas
- TOUT PLACID
- From your friendly neighborhood
- Follow Le Journal de Jane on WordPress.com
L’art de l’affiche


L’affaire est entendue, les films de Wenders n’étaient probablement pas aussi bons que ce qu’on pouvait en penser au début des années 80. Il n’empêche que ces deux affiches signées Guy Peellaert ornaient les murs de mon appartement parisien et je trouve en toute objectivité que c’était une décoration de bon goût. Lorsque je les revois aujourd’hui, je les apprécie toujours autant pour leur qualité artistique, et ceci indépendamment du halo de nostalgie qui s’en dégage inévitablement.
A lire ici, un entretien avec Peellaert.
Dans la galerie virtuelle du GFIV



A propos de Lee Miller, nous conseillons fortement le documentaire où l’on apprend beaucoup de choses sur une personnalité hors du commun (et le mot est faible). A voir ici.
Lecture
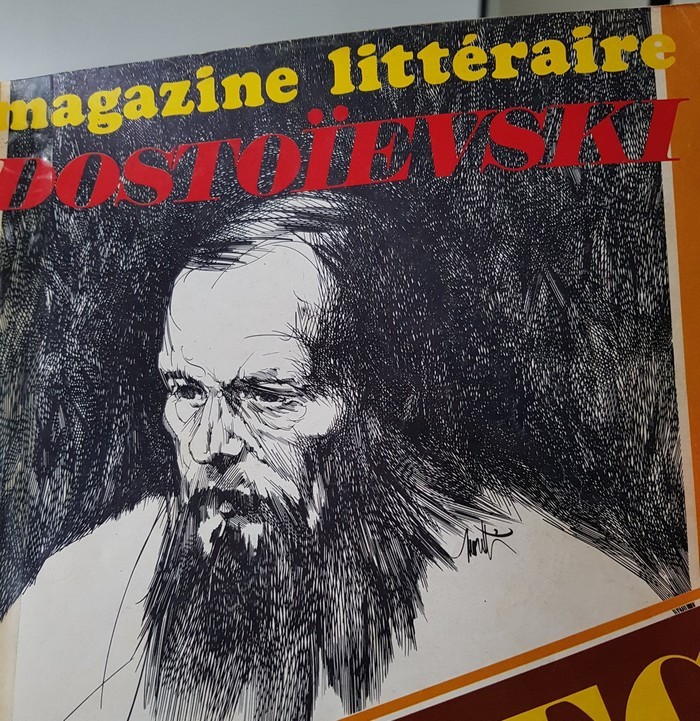
La littérature russe n’y est pour rien ; le cinéma, la musique et les autres arts non plus. J’avais commencé la lecture de L’Idiot avant le début de la guerre et je la poursuis avec ce principe élémentaire bien présent à l’esprit. Ceci d’autant plus que je passe de très agréables moments en compagnie du prince Muichkine (merci encore à ceux qui m’ont conseillé cette lecture). La construction du roman, digne d’une série pleine de surprises et de coups de théâtre, rend sa lecture captivante. C’est d’ailleurs au théâtre et à sa mise en scène que font penser les entrées et les sorties des personnages qui rythment les chapitres. Les personnages s’animent comme s’ils étaient joués par des acteurs et des actrices n’ayant pas peur d’en faire trop. L’agitation qui règne autour de lui fait ressortir le calme étrange du personnage principal dont on nous dit pourtant qu’il a été soigné pour ses crises d’épilepsie.
Les descriptions sont rares (adieu Balzac) mais lorsque Dostoïevski vous plante un décor en quelques phrases, il le fait de manière assez efficace. Extrait :
« Ils se retrouvèrent finalement sur la Liteïnaïa. Le dégel continuait toujours ; un vent triste, tiède et pourri, sifflait à travers les rues , les voitures clapotaient dans la boue, les chevaux de luxe et le haridelles des fiacres faisaient sonner leurs sabots ferrés sur la chaussée. Les piétons erraient en foule trempée et morose le long des trottoirs. On rencontrait des gens ivres. »
L’art de la reprise
Ou le parcours assez cocasse d’un titre dont l’origine se perd dans la nuit des temps, qui réapparait dans les années soixante avec le retour du blues acoustique puis repart sur les chapeaux de roues du côté de la Soul et du Rythm & Blues. On le retrouve sous forme de citation plus ou moins explicite chez les rockers de plusieurs générations. L’histoire se poursuit sur plusieurs saisons avec Tina Turner, Tim Hardin, Dylan et même… le Grateful Dead. Elle se termine plus ou moins avec Amy Winehouse qui la jouait sur scène mais n’a pas eu le temps de l’enregistrer proprement en studio.
Publié dans songs
Laisser un commentaire
Revu



L’éclipse, Michelangelo Antonioni (1962)
Pendant un long moment, j’ai eu un doute. Comme quand on croise quelqu’un qu’on a vaguement l’impression d’avoir déjà vu quelque part mais sans en être certain (et sans oser lui demander). Je me souvenais en revanche très bien de la scène où Delon et Monica Vitti marchent dans la rue. Ils longent un chantier d’immeuble en construction et arrivent à un carrefour désert, Delon dit en montrant le passage pour piétons : « Lorsque nous arriverons de l’autre côté, je vous embrasserai. » Faut-il voir les films d’Antonioni plusieurs fois pour qu’ils laissent des traces dans la mémoire ? La disparition récente de l’actrice principale éclaire d’une manière particulière sa présence à l’écran. On a rarement aussi bien filmé et mis en valeur la beauté et la personnalité d’une actrice. D’elle, j’avais oublié l’essentiel : sa manière de passer en un instant de la mélancolie la plus profonde à une légèreté enfantine puis de retomber dans une humeur morose. Le film montre quelques moments dans la vie d’une femme qui ne s’adapte pas à son environnement dominé par le matérialisme et l’appât du gain, représentés dans des scènes d’hystérie collective à la bourse et par les personnages avec lesquels elle ne parvient pas à communiquer : sa voisine, sa mère et son éphémère amant, sorte de trader vintage.
Vu


J’ai tout donné, François Reichenbach (1972)
On se distrait comme on peut. Je sais que je me situe là dans une zone de plaisirs vaguement honteux mais j’assume. Le film suit un Johnny en grande forme sur scène et surtout hors de scène, en tournée ou en vacances en Amérique avec Sylvie. Reichenbach est un très bon documentariste capable de capter avec justesse et discrétion les moments où la star se repose épuisée dans une chambre d’hôtel un peu minable ou lorsqu’il se prépare avant un concert au Palais des sports devant le Tout-Paris de l’époque. Les meilleurs moments sont ceux où la caméra suit le chanteur en tournée dans la province française de 1971. Les filles hurlent et montent sur scène pour toucher l’idole ; les extraits de concert sont brefs et c’est tant mieux, en revanche tout le reste est fascinant. On pense à Pennebaker lorsque la limousine de la star essaie d’avancer dans la foule comme dans Don’t Look Back ou que la caméra s’attarde sur des jeunes filles en extase qui ressemblent à celle du dernier concert de Ziggy Stardust. Et Johnny ? Il avait l’air sympathique et lucide.
Publié dans cinéma
Laisser un commentaire

